L'isotherme Zéro
Qu'est-ce que c'est ? A quoi ça sert ? Cela n'intéresse guère la gente citadine. Par contre, pour celui qui va en montagne et qui, souhaitons-le, tient compte des prévisions météorologique avant de partir, l'iso-zéro est bien souvent l'altitude à partir de laquelle il va geler. Cette méconnaissance s'exprime aussi à travers des commentaires comme : "L'iso-zéro était prévu à 2000 et c'était déjà gelé avant 1500 . . ."
Pour dissiper de telles ambiguïtés, il est donc nécessaire de donner quelques expliquations sur cet iso-zéro.
L'atmosphère
Quelques rappels.
La température de l'air décroît progressivement avec l'altitude (chacun de nous a pu l'observer) pour atteindre environ -50° C à la tropopause, que les nuages les plus élevés ne dépassent pas. Ce nom barbare désigne la limite supérieure de la troposphère qui est elle-même la partie inférieure de l'atmosphère. La troposphère, épaisse d'une dizaine de kilomètres, est la partie vivante de l'atmosphère.
Calcul fait, on s'aperçoit que la décroissance moyenne est de 0,65° C par 100 mètres. Après un palier, la température croît de nouveau dans la stratosphère jusqu'autour de 0° C vers 50 km, pour redescendre vers -80° C à la mesopause et croître de nouveau dans la thermosphère.
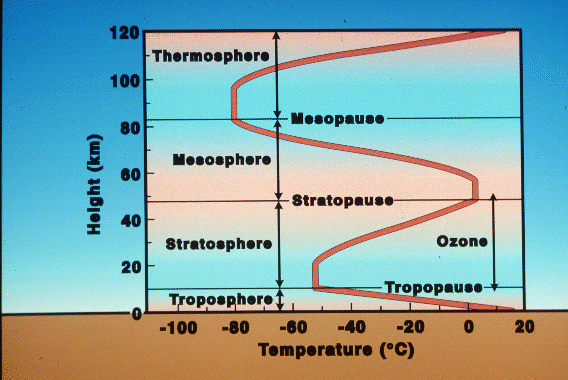
Extrait de
La météorologie, c'est l'affrontement perpétuel de masses d'air chaud et froid. Et dans une masse d'air donnée, la température varie en fonction de différents paramètres.
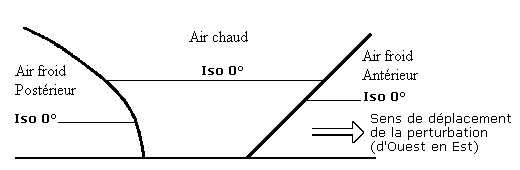
L'isotherme (mot féminin) zéro degré est le niveau d'altitude où la température de l'air passe par la valeur zéro en atmosphère libre, c'est-à-dire loin de toute influence due à l'état du sol (pente, sol enneigé, boisé, à l'ombre ou au soleil).
Le niveau de gel
Le niveau de gel est influencé par l'altitude de l'isotherme 0° C, mais en partie seulement. En effet, de jour le sol ou la neige se réchauffe, surtout au soleil ; la nuit c 'est un refroidissement par rayonnement vers le ciel, plus ou moins important suivant la couverture nuageuse. Le niveau de gel oscille donc autour de l'altitude de l'isotherme 0° C, vers le haut le jour, vers le bas la nuit. Des écarts importants peuvent se produire : en plein été, le sol peut geler à l'aube vers 2000 m, avec une isotherme 0° C vers 4000 m.
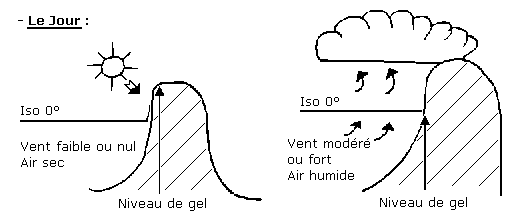
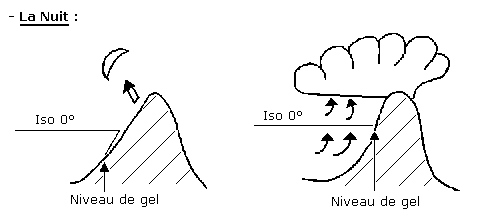
La topographie intervient aussi dans la mesure où les écoulements d'air venus des pentes supérieures propagent le refroidissement vers le bas. Ainsi, en été, tel couloir de neige sera bien gelé au petit matin parce qu'il canalise l'air froid de rayonnement, tandis qu'au même instant et à la même altitude sur une crête voisine, où l'air froid s'est évacué vers le bas, la croûte de regel sera seulement superficielle.
L'affaire se complique par les influences du vent et de l'état du sol.
Au contact d'un sol humide ou mouillé, un vent sec provoque une évaporation d'autant plus intense qu'il est rapide et pauvre en humidité. Il en résulte un refroidissement local (une main humide le ressent particulièrement). Autre exemple, la neige à flanc de montagne abritée du vent restera molle, tandis qu'à la même altitude (voire plus bas) elle sera glacée au niveau d'un col bien ventilé.
Au contraire, avec un vent très humide, de la vapeur d'eau se condensera à la surface de la neige qui sera superficiellement humide et ramollie. La condensation dégageant de la chaleur latente (c'est l'inverse de l'évaporation). C'est alors qu'avec une isotherme 0° C à 2500 m par exemple, la neige peut rester mouillée en surface jusque vers 2700 m dans un nuage.
Ce sont des observations faciles à faire sur le terrain. Dans un endroit découvert la neige peut être bien dure alors qu'en sous-bois le refroidissement est moins important et elle peut casser sous les skis ou être molle et gorgée d'eau.
Zéros multiples et inversions de température
Ce phénomène souvent durable correspond à la présence d'air froid à basse altitude. Littéralement captif sous une couche d'air plus chaud, cet air froid, parfois très humide en hiver, voit alors son sommet occupé par une couche nuageuse épaisse de quelques centaines de mètres (genre strato-cumulus), formant une mer de nuage, quand ce n'est pas la couche entière qui est saturée (brouillard). Le phénomène peut aussi exister sans matérialisation nuageuse et ne se soupçonnera alors que par la présence d'une barre sombre et bleutée qui est visible quand on se trouve sur les hauteurs.
Dans l'exemple qui suit les températures et altitudes ne sont qu'indicatives.
Dans la première couche d'air froid, la température décroît progressivement. Ainsi partant par exemple de +3° C dans une vallée, on atteindra 0° C vers 700 à 800 m (première iso-zéro). Pour une couche d'air épaisse de 1500 mètres, nous atteindrons environ -4° C à son sommet. A partir de cette altitude, en sortant de la mer de nuages, changeant de couche d'air, les températures s'élèveront de nouveau (inversion de température), pour remonter parfois nettement au-dessus de 0° C. Nous aurons alors une deuxième iso-zéro vers 1800 m. Cette remontée de température s'arrête après quelques centaines de mètres, vers 2200 mètres, pour décroître de nouveau normalement.Et nous aurons une troisième isotherme 0° C vers 2500 mètres.
Ce phénomène, assez courant en hiver, peut être plus marqué que dans l'exemple ci-dessus, surtout en automne ou au printemps (températures de +13 à +17° C en moyenne montagne alors qu'en plaine, il fait +5 à +8° C, la troisième iso 0° C étant alors située vers 4000 mètres). Lorsque la température est négative en plaine, on ne trouve plus que deux iso-zéro. Mais lorsque le phénomène se superposé plusieurs fois, les iso-zéro sont bien plus nombreuses.